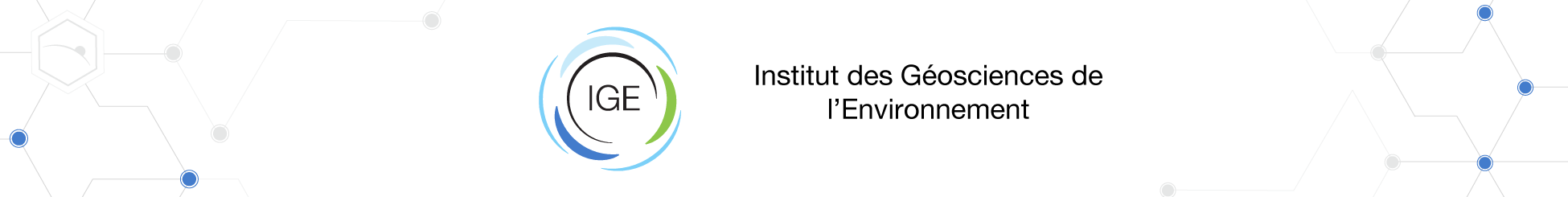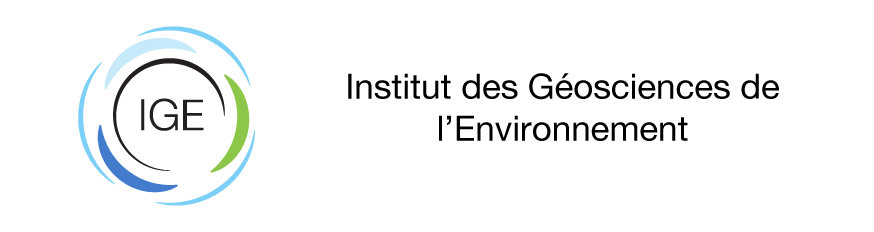COP biodiversité et climat : passer des promesses à l’action

la COP16 devait confirmer l’élan collectif nécessaire pour inverser
la perte de biodiversité et atteindre les objectifs fixés.
photo : IRD - Thomas Couvreur
Auteur d’une publication sur les objectifs de conservation de la nature, Ignacio Palomo, chercheur IRD à l’institut des géosciences de l’environnement (IGE-OSUG, CNRS/IRD/UGA/INRAE/GrenobleINP-UGA) analyse les attentes et enjeux des COP biodiversité et climat.
« Vous l’avez probablement vu partout dans les journaux : des dirigeants du monde entier se sont réunis fin 2024 à Cali, en Colombie, pour la COP16 sur la biodiversité [1] et à Bakou, en Azerbaïdjan, pour la COP29 sur le climat [2]. Pour les non-initiés, COP est l’acronyme de conférence des parties, terme générique désignant des sommets annuels auxquels participent tous les pays signataires de la Convention des Nations unies. Ils y prennent des décisions sur toutes les questions jugées utiles pour atteindre les objectifs des conventions internationales concernées – comme le climat ou la biodiversité en l’occurrence.
Chacun de ces deux événements avait des orientations et attentes claires. La COP16 sur la biodiversité était l’objet de toutes les attentions car, lors de la précédente COP15 à Montréal, les pays ont adopté le Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal (KMGBF) afin de stopper et d’inverser la perte de biodiversité. Il s’agissait alors de voir les pays maintenir le rythme pour atteindre les objectifs convenus lors de cette nouvelle COP. Quant à la COP29 sur le climat, elle focalisait les esprits autour des contributions financières des pays développés en faveur des pays en développement. L’occasion d’arrêter des montants visant à soutenir leurs efforts d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Mais, dans les deux cas, ces attentes n’ont été que partiellement satisfaites : malgré certains progrès, le rythme doit être accéléré si les pays veulent atteindre les objectifs de conservation de la biodiversité fixés pour 2030. Il en va de même pour que les pays en développement se protègent des effets du changement climatique et soient en mesure de passer à une économie à faible émission de carbone.
Des financements insuffisants
S’agissant de la COP16 sur la biodiversité, plus de 85 % des pays n’ont pas respecté la date limite de présentation de leurs stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité. Il faut dire qu’ils ne sont pas légalement tenus de le faire. Une absence d’obligation légale qui pourrait entraver la réalisation des objectifs en matière de biodiversité. De plus, seuls huit gouvernements se sont engagés à verser un total de 163 millions de dollars au Global Biodiversity Framework Fund (GBFF) [3], alors que 700 milliards de dollars par an sont nécessaires à la préservation de la biodiversité, selon le rapport sur le financement de la nature, publié par Nature Conservancy [4].
Cependant, la COP16 a aussi été marquée par deux notes positives, venues de l’intégration formelle des communautés indigènes dans la prise de décision officielle du processus de biodiversité des Nations unies, et de la taxe mondiale convenue pour les produits utilisant des données génétiques de la nature, qui sera utilisée pour financer la conservation et soutenir les communautés indigènes. Bien qu’il s’agisse d’avancées de la plus haute importance, au point que certains ont appelé la COP16 la COP des peuples, elles ne constituent pas une percée suffisante pour atteindre les objectifs du KMGBF d’ici 2030.
Dans le cadre de la COP29 sur le climat, les nations développées ont promis 300 milliards de dollars par an de financement climatique aux pays en développement d’ici 2035. Un progrès significatif par rapport à l’accord précédent qui s’élevait à 200 milliards de dollars, mais dont l’estimation convenue est bien inférieure aux 2 400 milliards de dollars annuels demandés par les pays en développement et alignés sur la base d’un rapport de scientifiques et d’économistes reconnus, présenté lors de la COP.
Une courbe à infléchir
Un article scientifique que nous avons publié le mois dernier fait le point sur les progrès accomplis dans la réalisation de trois objectifs mondiaux de conservation de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique convenus au niveau international pour 2030. Le premier objectif, fixé dans le cadre du KMGBF de la CDB, engage toutes les parties à protéger au moins 30 % des zones terrestres, des eaux intérieures et des zones côtières et marines d’ici à 2030. Le deuxième objectif, fixé lors de la COP26 sur le climat dans le cadre de la « Déclaration des dirigeants de Glasgow sur les forêts et l’utilisation des terres », engage les signataires à « stopper et inverser la perte de forêts » d’ici à 2030. Le troisième objectif, issu du défi de Bonn pour la restauration, vise à restaurer 350 millions d’hectares de paysages dégradés et déboisés d’ici à 2030.
Notre analyse des tendances passées et des projections futures montre que dans un scénario de statu quo, aucun de ces objectifs ne serait atteint d’ici à 2030. Comme l’a dit la biologiste Georgina Mace, pour combler l’écart entre les tendances actuelles et ces objectifs, il faut prendre des mesures qui « infléchissent la courbe » et provoquent des changements substantiels par rapport aux tendances du statu quo. Ce que nous avons vu lors des COP est loin d’apporter le changement nécessaire pour stopper et inverser la perte de biodiversité et atteindre les objectifs en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.
De nombreux freins et quelques leviers d’amélioration
Plusieurs éléments doivent être pris en compte lors de l’évaluation des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs. Tout d’abord, nous devrions nous demander ce qui fait avancer les choses dans la direction opposée aux objectifs. Les subventions nuisibles à l’environnement, qui ont été estimées pour 2024 à 2,5 % du PIB mondial (soit 2 600 milliards de dollars), sont non seulement incompatibles avec les objectifs, mais elles ne cessent d’augmenter (d’environ 800 milliards de dollars au cours des deux dernières années). Parmi elles, on peut par exemple citer l’exonération de taxes sur les carburants pour le transport aérien commercial. De même, autoriser 2 456 lobbyistes des énergies fossiles à la COP28 [5] ne contribue pas à garantir que les gouvernements puissent prendre les meilleures décisions pour gérer le climat.
En politique internationale, le résultat des élections américaines n’a pas été bien accueilli par les instances climatiques, et ce pour de bonnes raisons. Les recherches devront d’ailleurs évaluer l’impact des mesures protectionnistes brandies en matière de changement climatique. En limitant la circulation de technologies vertes bon marché vers les régions qui en ont le plus besoin, elles pourraient en effet entraver une nécessaire transition énergétique. Pour autant, le découragement ne saurait limiter notre capacité d’action car un seul gouvernement, aussi puissant soit-il, ne façonnera pas l’avenir des émissions de CO2. Ainsi, chaque année les énergies renouvelables, et en particulier les panneaux solaires, deviennent moins chères. La part des énergies renouvelables dans la capacité totale installée a atteint 86 % en 2023.
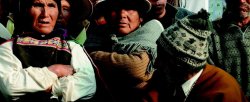

Comme nous le montrons dans l’article sur les objectifs mondiaux de conservation et de lutte contre le changement climatique convenus pour 2030, des progrès rapides vers les objectifs ont été réalisés dans le passé pour certains indicateurs. Par exemple, les aires marines protégées ont connu une expansion rapide et sans précédent entre 2006 et 2017. En ce qui concerne la déforestation, des pays tropicaux ont été en mesure de réduire fortement leur taux de déforestation au cours de certaines périodes. Il ressort de notre analyse que dans ces cas, plutôt que sur des solutions miracles, les progrès reposent sur une diversité d’éléments, notamment la gouvernance environnementale, les facteurs économiques, les valeurs et les connaissances. Des recherches supplémentaires pourraient nous aider à mieux comprendre comment ces leviers peuvent être combinés dans l’espace et dans le temps afin d’accélérer les progrès vers les objectifs de conservation mondiaux.
Des problématiques largement connectées
Comme l’a conclu l’atelier coparrainé par l’IPBES [6] et le GIEC [7] sur la biodiversité et le changement climatique, ces deux enjeux sont le plus souvent traités séparément alors qu’ils sont largement interconnectés. La recherche doit continuer à montrer les synergies et les compromis entre la biodiversité et le climat. Cette exploration devrait inclure des approches interdisciplinaires intégrant les sciences sociales et humaines à la biodiversité et à la science du climat, afin de comprendre comment les contextes individuels, collectifs et institutionnels sont liés à la biodiversité et au climat.
Dans le monde dynamique d’aujourd’hui, la science et la coproduction de connaissances sont plus que jamais nécessaires pour relever les défis complexes auxquels nous sommes confrontés. Dans ce contexte, l’IRD est une organisation unique pour répondre à ces défis dans le cadre d’une approche inter et transdisciplinaire. »
Références
Ignacio Palomo, Alberto González-García, Paul J. Ferraro, Roldan Muradian, Unai Pascual, Manuel Arboledas, James M. Bullock, Enora Bruley, Erik Gómez-Baggethun & Sandra Lavorel, Business-as-usual trends will largely miss 2030 global conservation targets, Ambio, 07 novembre 2024
doi : 10.1007/s13280-024-02085-6
Contacts scientifiques locaux
– Ignacio Palomo, chercheur IRD à l’IGE-OSUG | ignacio.palomo univ-grenoble-alpes.fr
Cet article, a initialement été publié par IRD le Mag’.
[1] La COP de la Convention sur la diversité biologique (CDB) est un traité international adopté lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, visant trois objectifs principaux : conserver la biodiversité, utiliser ses éléments de manière durable et assurer un partage équitable des avantages issus de l’exploitation des ressources génétiques.
[2] La COP de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) est adoptée par 197 pays et constitue le premier cadre international majeur à reconnaître les changements climatiques et leurs impacts.
[3] Créé par la COP15, a pour mission de soutenir les pays en développement dans la mise en œuvre du Cadre Mondial pour la Biodiversité de Kunming-Montréal.
[4] Qui propose l’une des évaluations les plus complètes sur les sommes actuellement dépensées dans le monde en faveur de la nature, sur les sommes supplémentaires à dépenser et sur la manière dont ce déficit de financement peut être comblé dès maintenant. https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/closing-nature-finance-gap-cbd/
[5] Selon l’Europe Corporate Observatory, chiffre repris par la presse (The Times, The Guardian...) dont la méthode de calcul est publiée https://corporateeurope.org/en/2023/12/record-number-fossil-fuel-lobbyists-granted-access-cop28-climate-talks
[6] La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (en anglais : Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) est un groupe international d’experts sur la biodiversité.
[7] Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, ou GIEC, est un organisme intergouvernemental chargé d’évaluer l’ampleur, les causes et les conséquences du changement climatique en cours.
 La fédération
La fédération Intranet
Intranet